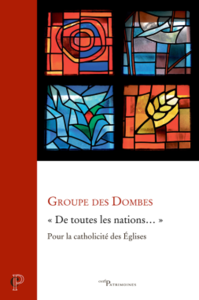 « De toutes les nations… » Pour la catholicité des Églises(1) est le dernier ouvrage du Groupe des Dombes. Pourquoi réfléchir œcuméniquement à la catholicité ? Quelle est la pertinence d’un tel thème pour nos Églises ? Les propos qui suivent ne rendent pas compte de l’ensemble de l’ouvrage, mais proposent quelques éléments partiels qui rendent compte d’une partie de la démarche du Groupe des Dombes.
« De toutes les nations… » Pour la catholicité des Églises(1) est le dernier ouvrage du Groupe des Dombes. Pourquoi réfléchir œcuméniquement à la catholicité ? Quelle est la pertinence d’un tel thème pour nos Églises ? Les propos qui suivent ne rendent pas compte de l’ensemble de l’ouvrage, mais proposent quelques éléments partiels qui rendent compte d’une partie de la démarche du Groupe des Dombes.
Quelques éléments de présentation du Groupe des Dombes
Ce groupe, créé en 1937 par l’abbé Couturier et le pasteur réformé suisse Baümlein, est, depuis quelques décennies, composé de vingt membres catholiques et de vingt membres protestants, dont la plupart sont luthéro-réformés, mais on compte aussi une membre épiscopalienne et une membre mennonite. Il y a certes des théologiens chercheurs, mais aussi des pasteurs et des prêtres de terrain. Un aspect important du travail de ce groupe est qu’il ne repose pas uniquement sur la réflexion théologique et conceptuelle, mais souhaite prendre en compte l’expérience concrète de chacun. L’expérience œcuménique de terrain reste première. Cette précision est importante, car elle souligne aussi que les travaux du Groupe des Dombes ne souhaitent pas s’adresser uniquement au monde de la théologie, mais visent également le monde des paroisses et assemblées locales, les aumôneries, etc., c’est-à-dire tous les lieux où les croyants (et non les seuls théologiens et pasteurs !) sont engagés. De plus, une autre dimension à laquelle le Groupe des Dombes accorde une grande importance est le fait d’être « interrompu » régulièrement par la prière. En effet, trois fois par jour, ses réflexions et partages sont rythmés par la prière commune, la prière liturgique. J’ose parler d’« interruption », car cela signifie qu’une priorité est donnée aussi à la prière, considérée comme un lieu où l’unité est reçue, où le soutien de Dieu et le souffle de l’Esprit sont demandés et accueillis. L’abbé Couturier, l’un des initiateurs de ce groupe, souhaitait que les écrits témoignent « d’une théologie ruisselante de prière ». Ainsi, relations fraternelles, prière, réflexion théologique et partage de nos expériences personnelles sont la matrice de nos rencontres annuelles, fin août, à l’abbaye bénédictine de Pradines (Loire).
Une redécouverte du sens du mot « catholicité »
L’ouvrage sur la catholicité est celui qui a demandé le plus de temps de travail au Groupe des Dombes : plus de onze années ! Cela indique qu’il n’est pas si aisé et spontané de travailler œcuméniquement sur ce thème. Certes, le titre lui-même est biblique : « De toutes les nations [faites des disciples]… », et affirme l’importance de l’envoi en mission qui vise une totalité (« toutes »). Il indique l’articulation entre catholicité et annonce de l’Évangile, donc entre catholicité et mission : voilà ce que le titre et le sous-titre donnent à entendre d’emblée au lecteur qui ne voit peut-être pas l’évidence de ce lien. Le sous-titre Pour la catholicité des Églises est un choix « osé »… surtout lorsque l’on sait que la moitié du groupe est composée de protestants. Les titres des précédents ouvrages du Groupe des Dombes étaient spontanément plus simples à accueillir pour des protestants : Pour la communion des Églises ou encore Pour la conversion des Églises. Cette fois-ci, la barre est plus haut sans doute ! Nous en avons eu conscience dès le début de ce travail. Cela tient au fait que ce terme de « catholicité » véhicule un certain nombre de malentendus et produit souvent comme une réaction allergique presque « instinctive » de la part des protestants. En effet, si les protestants, en général, confessent avec le Credo « je crois l’Église une, sainte, catholique et apostolique », cela a été traduit, en français en tout cas, par « universelle ». Le mot « catholique » est souvent évacué. Donc du côté protestant, non seulement il y a malentendu, mais nous avons réduit le sens de « catholicité » en considérant par exemple que ce mot désigne seulement l’Église « catholique romaine », ou encore qu’il ne dit que la catholicité géographique (ce qu’« universelle » veut dire). Du côté catholique, on peut dire que ce mot a comme été « confisqué », car la perception spontanée est la suivante : seule l’Église catholique est catholique ! Parallèlement, on pense souvent que le mot « réforme » est réservé aux seuls protestants… On constate donc que la plupart des traditions ecclésiales se sont accaparé certains termes qui deviennent alors exclusifs et perdent leur vrai sens.
L’enjeu est donc de retrouver le sens de ce mot « catholique » ou « catholicité » qui, en fait, désigne la totalité de la foi, ou encore l’unité dans la diversité. La catholicité n’a donc pas qu’une dimension quantitative (qu’exprime le sens d’universel, qui est surtout géographique). Il nous faut aussi retrouver le sens de la catholicité dans l’histoire, c’est-à-dire l’empreinte du christianisme dans toute l’histoire. On comprend peu à peu que la catholicité a aussi une dimension qualitative : elle désigne la plénitude de la foi, la plénitude de l’Évangile annoncée à toutes les cultures… Par-dessus tout, la catholicité est à comprendre comme désignant la profondeur et la qualité des liens qui unissent nos Églises, ces liens qui sont appelés à être des liens de communion.
C’est à cela que s’attache ce travail : comprendre la catholicité comme un don de Dieu (à l’exemple de l’unité, la sainteté, et l’apostolicité) qui est fait à toutes les Églises, un don qui doit être approfondi et converti sans cesse. En ce sens, la catholicité est dynamique, en mouvement, et travaille à l’intérieur même de nos Églises. Nous parlons à plusieurs reprises dans ce travail (d’ailleurs non sans humour), de « catholicité réformée », car la catholicité est sans cesse un mouvement de conversion et de réforme.
Un mot qui n’est pas biblique ?
Les mots « catholicité » ou « catholique » ne sont pas employés dans la Bible. Il a paru évidemment important au groupe des Dombes de mener une enquête biblique afin de discerner où se trouvent les fondements scripturaires de la catholicité et comment l’Écriture peut nous aider à comprendre cette notion. Certes, cette enquête ne pouvait être que partielle… Le thème de l’universalité est bien sûr présent dans la Genèse, dans les textes prophétiques, les psaumes et la littérature sapientielle :
« L’unicité du Seigneur comme Dieu confère une portée universelle à son œuvre créatrice et à sa souveraineté. Cette universalité peut être pensée comme extension de son œuvre. » (§464)
Cette universalité est inclusive et « demande que les plus pauvres aient aussi part aux bénédictions de Dieu » (§464). En étudiant de plus près les livres d’Esdras et de Néhémie, on s’aperçoit que l’unité est restaurée, donnée au peuple revenu de l’exil grâce à la reconstruction du Temple, l’observance de la Loi et le chantier des murailles de Jérusalem : « l’unité se construit à partir d’un centre qui organise la vie commune et détermine l’identité ». Cela signifie aussi pour chaque génération « un retour à Dieu et une réforme » (§462). L’Ancien Testament est traversé par un appel à l’universalité « qui exige à la fois unité et pluralité » (§465).
Dans le Nouveau Testament, la lecture du Groupe des Dombes met en exergue les déplacements audacieux de Jésus en territoire païen, les paroles du ressuscité envoyant ses apôtres « à toutes les nations », ou encore la rencontre avec la Samaritaine. Les Actes des apôtres témoignent du don universel de l’Esprit, et relatent l’importance de la conversion personnelle et communautaire qu’implique cet appel à l’universalité. En effet, Pierre et Paul vont voir « leurs convictions les plus intimes complètement bouleversées » (§484) avant d’être envoyés en mission : « Une seconde caractéristique essentielle à la catholicité de la mission apostolique est la transformation qu’elle implique de la part de la communauté et de ses membres. » (§484) Actes 15 rend compte de cette conversion communautaire qui, lors de l’assemblée réunie à Jérusalem, a permis « le rassemblement, sans confusion, des courants séparés du christianisme naissant. La nouveauté est bien que la cohésion de la communauté chrétienne au sens large, autrement dit l’Église, n’est plus déterminée par l’appartenance ethnique » (§487). Ce qui sera encore confirmé par les épîtres pauliniennes :
« L’Église, corps du Christ, est une : elle se définit comme réconciliation (sans disparition) de deux entités historiques préalables, les Juifs et les nations. » (§497)
Et les Églises de professants ?
Pour la première fois dans un de ses ouvrages, le Groupe des Dombes consacre plusieurs pages au dialogue avec les Églises de professants. Il est étonnant de constater que plusieurs dialogues internationaux et européens impliquant évangéliques, baptistes, pentecôtistes, mennonites, etc., réfléchissent sur ce terme de catholicité, notamment en lien avec la koinonia. Ainsi, le dialogue international baptiste-catholique écrit : « La communion universelle de l’Église de Jésus-Christ peut être avec justesse appelée « catholique(2). » Les baptistes affirment alors que, si la catholicité est comprise, dans le temps et l’espace, comme la plénitude de la manifestation de Dieu en Christ et comme la plénitude de l’Évangile, alors eux aussi « se considèrent comme catholiques(3) ». Cependant, les baptistes précisent que la plénitude de l’Évangile n’implique pas la plénitude ou catholicité de l’Église au sens où les catholiques la comprennent, c’est-à-dire « dans le sens d’une unité visible et organique et d’une extension universelle à tous les peuples et l’espace(4) ». L’insistance baptiste porte ici sur la promesse non encore réalisée, que ce soit pour l’unité, la sainteté et la catholicité(5) (cf. §385). Tous les dialogues le constatent : redécouvrir le sens du mot « catholique » ou « catholicité » revient à interroger la manière dont nous articulons, dans nos Églises de professants, souvent congrégationalistes, la dimension locale et translocale, l’unité et la diversité. On notera aussi que la toute récente Proclamation de Séoul du Mouvement de Lausanne utilise explicitement ce qu’on nomme les « marques » de l’Église : une, sainte, catholique, et apostolique. Il est donc nécessaire d’approfondir ces termes.
Plus qu’un mot controversé, la « catholicité » vient interroger notre compréhension de la notion de koinonia. Ce mot de « communion » se trouve dans la thèse à laquelle aboutit l’ouvrage des Dombes : « l’Église catholique et les Églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu’en communion imparfaite ». L’enjeu est notre appartenance commune au corps du Christ.